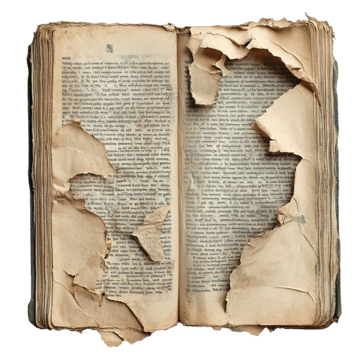
Vendredi 7 novembre 2025
À rebours du fatalisme distillé par l’époque ou par certains, qui voudrait que le livre soit source de déception et que nos espérances s’y fracassent, il convient de rappeler – non pas sur le ton de la défense, mais en chantre inconditionnel de l’art littéraire – ce que doit à l’humanité le roman, l’auteur, et toutes ces tentatives d’inventer ou de recréer le monde. Il faut proclamer avec force : non, les livres ne déçoivent point, sauf si l’on confie à ce mirage d’attente le soin de guider la rencontre. Comme l’amour adulte, la lecture se mérite et s’apprivoise ; elle s’offre à qui, vierge de toute idée préconçue, vient sans bagage, prêt à la traversée et au ravissement.
Le livre n’a pas à répondre à mes chimères, ni à me satisfaire selon un barème secret. Il existe pour faire naître en moi ce que je n’osais imaginer, pour ouvrir des brèches où je n’attendais rien, pour semer l’inédit dans le champ du déjà-là. L’auteur, fragile démiurge, ne maîtrise ni la fortune des mots ni l’alchimie de l’émotion. Il se livre tout entier, parfois avec maladresse, quelquefois avec fulgurance, rarement avec ce détachement que prétendent les esprits blasés. La beauté du roman naît de ce risque, de cette traversée dans l’incertitude, dans la générosité et la patience, où la moindre page, même faible, recèle une offrande.
Que la qualité soit inégale, c’est affaire de nature humaine : qui prétendrait que seul l’excellent mérite écoute ? Les failles et les tâtonnements constituent la texture même du vivant ; un chapitre boiteux ou une intrigue bancale ne sont, parfois, que le prix à payer pour accéder à la sincérité de la voix et à la lumière qui affleure, là où l’on ne l’attendait point. Les livres imparfaits sont aussi des livres vivants, amoureux de la multiplicité des mondes et des sensibilités. Et qui n’a pas ressenti, devant une œuvre maladroite mais sincère, ce choc de reconnaissance, cette intuition d’un dialogue inespéré ?
L’écrivain, artisan du verbe, consacre des années à façonner son univers : le roman n’est jamais simple divertissement, mais opération risquée, circulation souterraine de passions, de questionnements, d’appels. La création littéraire, dans l’ombre ou sous les projecteurs, dépend de cette volonté farouche d’aller jusqu’au bout de soi, d’offrir une parcelle de vérité sans garantie de la voir comprise. L’échec éventuel est aux antipodes de la déception : il signifie seulement que l’aventure fut tentée, que la main fut tendue. Le livre n’est décevant que si l’on exige de lui qu’il réponde fidèlement à un schéma, alors que son dessein véritable est d’ouvrir, de déplacer, de transformer.
De fait, nulle lecture ne devrait commencer sous la bannière de l’attente – ni du chef-d’œuvre supposé, ni du soulagement des soifs connues. L’entrée en littérature, la vraie, exige un abandon semblable à celui du voyageur dans la nuit, qui consent à laisser hors de la chambre ses certitudes, et à se laisser porter par la brise, l’odeur, la couleur des phrases. C’est à ce prix qu’un livre, même trivial, peut devenir amont, source, épiphanie.
Le lecteur authentique apprend vite le respect devant l’effort, devant l’audace, devant l’infime originalité d’une construction narrative. Que tout n’éblouisse pas importe peu ; l’essentiel réside dans le dialogue muet, dans la possibilité de se perdre sur la carte nouvelle du langage. En cela, chaque roman ajoute une pièce au grand édifice de la mémoire humaine : il raconte, il transmet, il relie entre eux les égarés, les rêveurs, les chercheurs d’ailleurs. L’auteur, humble ou grandiloquent, fonde des mondes afin que les nôtres puissent s’élargir sans violence – et il offre au lecteur le pari le plus fou : croire en l’inédit, s’abandonner à la route inconnue, prendre le risque de la surprise et du vertige.
Ainsi, lire sans grande attente, c’est se préparer à accueillir, à recevoir, à naître au fil des pages – même là où l’on ne cherchait point de miracle. Le roman, dans sa banalité parfois dérangeante, dans sa splendeur fugitive, porte chaque époque, chaque souffrance, chaque ivresse au-delà d’elle-même. Les mauvais livres eux-mêmes témoignent du besoin d’humanité, du désir de dire, de partager une étincelle. Rien n’est jamais perdu pour celui qui consent à jeter l’ancre sans trop de calcul.
Il faut donc oser le panégyrique du livre, du romancier, de l’explorateur du verbe : c’est leur imperfection, leur ardeur, leur persistance qui forment les continents secrets de notre histoire commune. S’imaginer que seuls quelques volumes justifient notre confiance, c’est confondre le possible et l’exception, c’est trahir la diversité de l’esprit et du cœur. À chaque nouvelle rencontre, le lecteur – s’il se dépouille de sa cuirasse d’espoir et de ses béquilles d’exigence – trouve dans le roman non un remède, mais un passage, un seuil, une fenêtre sur l’infinitude du sensible.
Alors, cessons de demander aux livres de tenir des « promesses » : ils n’en ont pas fait. Ils ne nous doivent ni consolation, ni perfection, ni caresse d’ego. Ils nous doivent seulement ce tremblement d’âme qu’aucune autre œuvre n’offre avec autant d’honnêteté. Lire, c’est consentir à l’inconnu, c’est accepter d’être un peu déplacé dans sa chair et ses certitudes.
Chaque roman, même boiteux, rallume la braise du monde. Et si parfois l’on sort désorienté, tant mieux : c’est le signe qu’un auteur a réussi son passage, qu’il a déplacé un souffle. Car la littérature — de l’échoppe modeste au plus grand des temples — ne déçoit jamais : elle dérange, elle soulève, elle continue de nous inventer.
**************************************************
